Nos rêves : Moteur d’espoir ou pièges de l’illusion

Que deviennent nos rêves ? Ceux que nous avons réalisés, abandonnés, ou oubliés avec le temps. Sont-ils faits pour nous guider, pour nous élever, ou pour nous hanter ? Rêver est-il une force qui nous pousse à avancer, ou une quête sans fin qui fait de nous des éternels insatisfaits ? Et si le rêve était à la fois une lumière et une ombre dans nos vies ?
En écoutant l’émission Grand bien vous fasse sur France Inter, diffusée le 24 décembre 2024 et consacrée au thème Avez-vous réalisé vos rêves ?, j’ai découvert une voix qui a profondément résonné en moi : celle de Marianne Chaillan, philosophe et auteure, entre autres, de « Ecrire sa vie » (Editions L’Observatoire, 2024). Ses propos m’ont amené à avoir une réelle réflexion sur nos rêves et ce que nous en faisons.
Rêves inachevés
Je suis ce que l’on qualifie d’une rêveuse. Je rêve la nuit, le jour…je rêve et je ne m’arrête pas de rêver. Le problème dans cette existence de rêve est que j’ai des rêves mais qu’à ce jour j’en ai accomplis aucun. Chercher l’erreur…A 46 ans…il serait peut-être temps de se féliciter de la réalisation d’un de ses rêves. Frustration, perte de confiance en moi, estime de moi en décadence…un cocktail amer et toxique. Que s’est-il passé ? Pourquoi ces échecs à répétition ? Pourquoi tant de rêves inachevés ?
Volonté et sacrifices : sont-ils vraiment les clés du succès ?
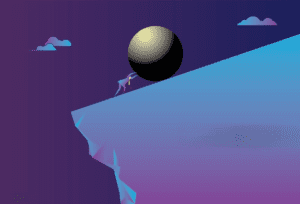
Dans son ouvrage Célèbre (Éditions L’Iconoclaste, 2024), Maud Ventura nous plonge dans l’histoire de Cléo, une héroïne portée par un rêve absolu : devenir une popstar mondialement reconnue. Mais à quel prix ? « Il y a toujours un renoncement dans le rêve », affirme l’auteure au cours de l’émission. Une réflexion partagée par Julien Sandrel, auteur de La chambre des merveilles (Calmann-Lévy, 2018).
Ces mots résonnent profondément : ai-je échoué par manque de volonté ? Aurais-je dû faire davantage de sacrifices ? Des nuits blanches, des week-ends sacrifiés, une vie personnelle mise entre parenthèses… L’effort était là, mais mes rêves, eux, n’ont jamais pris forme. Alors, le problème se situe-t-il ailleurs ? Existe-t-il des éléments invisibles, indépendants de notre contrôle, qui déterminent l’issue de nos aspirations ?
C’est ici que les propos de Marianne Chaillan prennent toute leur portée. Face à la question « S’est-on vraiment donné les moyens de réaliser nos rêves ? », la philosophe nuance. Selon elle, l’atteinte d’un rêve ne repose pas uniquement sur notre volonté ou nos sacrifices. « Est-ce que ce n’est pas une question de chance , une complexion de facteurs qui nous permet à la fin que certains de nos rêves ait été réalisés », interroge-t-elle.
La chance, le hasard, les circonstances de la vie… autant de variables que l’on ne maîtrise pas. Cela nous amène à réfléchir autrement : « Et si le plus important n’était pas de réaliser nos rêves, mais simplement de rêver ? » Avoir des rêves, c’est déjà entretenir un moteur intérieur, un élan vital. Parfois, rêver pour rêver suffit à donner du sens, sans que l’accomplissement ne devienne une obligation.
Rêver : entre moteur de vie et piège de l’idéal
Rêver est un moteur puissant, qui nous pousse à avancer. Marianne Chaillan, philosophe, évoque cet élan à travers une citation de Peter Pan de Disney : « Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur. » Pourtant, le rêve possède aussi une face plus sombre, comme l’illustre La Petite Sirène. Ici, les dangers du rêve sont au cœur de la morale : poursuivre un idéal peut parfois se transformer en « bovarysme », selon les termes de la philosophe, où le rêve nous empêche de savourer le réel au profit d’un fantasme. En somme, trop rêver peut nous éloigner de l’instant présent et de la satisfaction simple d’exister.

Ce qui nous amène à nous interroger sur nos choix de vie, nous sommes souvent tentés de nous demander : et si j’avais pris une autre direction ? Aurais-je atteint la vie rêvée à laquelle j’aspirais ? L’auteure déconstruit cette peur de l’erreur. Pour elle, « on peut se tromper de chemin, et ce n’est pas grave. » Elle va même plus loin en affirmant : « On ne se trompe pas de chemin. On fait comme on peut avec ce qu’on est, au moment où on est. » Une invitation à embrasser nos parcours, avec leurs détours et leurs imperfections, comme des étapes légitimes de notre existence.
Les rêves réalisés : une quête de sens ou une illusion de réussite ?
Marianne Chaillan poursuit en soulèvant une question essentielle : « Ne reconstruisons-nous pas, a posteriori, l’idée qu’un de nos rêves a été accompli ? » Peut-être avons-nous rêvé de mille choses, certaines oubliées, d’autres abandonnées en cours de route. Et pour ces rêves réalisés, ne s’agit-il pas d’une relecture rétrospective, où nous choisissons de considérer comme accompli ce qui, un jour, nous a semblé correspondre à une aspiration passée ?

Finalement, la réalisation de nos rêves ne dépend-elle pas, en partie, de la chance ou des circonstances ? Ne pas les accomplir ne signifie pas forcément un manque de volonté ou d’efforts, mais plutôt que la vie n’a pas répondu comme nous l’espérions. « On rêve nos rêves, comme si on reconstruisait l’idée même d’avoir rêvé une chose », explique la philosophe.
Le rêve, côté pile, est une source d’élan. Écouter Jean-Jacques Goldman chanter « J’irai au bout de mes rêves » peut insuffler une énergie vitale immense. Mais côté face, il peut aussi devenir un poids, une source de tristesse lorsqu’il reste inachevé. Dans ces moments, Marianne Chaillan invite à « faire un pas de côté » et à accueillir humblement ce que la vie nous a offert, même si cela ne correspond pas exactement à nos idéaux. Car souvent, ce qui nous est arrivé est, en fin de compte, ce qui devait nous arriver.
L’ambivalence du rêve : entre élan vital et désillusion

En sommes, la philosophe met en garde contre les excès du rêve : « Ceux qui rêvent trop, ou qui se convainquent que leur rêve se réalisera, risquent de se heurter violemment à la réalité de l’existence. » Cette mise en garde souligne le danger d’une déconnexion entre le fantasme et le réel, où l’écart peut engendrer désillusion et souffrance.
Maud Ventura, dans son ouvrage, propose une perspective plus positive : le rêve peut être un tremplin vers une quête d’authenticité, nous aidant à trouver notre juste place, en accord avec nos aspirations profondes. Cette quête peut mener à une forme de réalisation personnelle, une sensation d’être enfin là où nous devons être.
Pourtant, Marianne Chaillan nuance cet élan en posant une question cruciale : et après ? « Est-ce qu’un rêve ne nous confronte pas, une fois atteint, à ce sentiment : ah bon, c’était juste ça… et maintenant ? » Elle cite l’actrice espagnole Marisa Paredes, qui, dans Tout sur ma mère d’Almodóvar, confie : « La célébrité n’a ni saveur ni odeur. Une fois habitué, c’est comme si elle n’existait pas. » Cette réflexion ouvre une interrogation fondamentale : doit-on réellement chercher à réaliser ses rêves, ou est-ce la quête elle-même, le chemin parcouru, qui importe davantage ?
L’ambivalence du rêve exige vigilance. Flaubert, à travers Mme Bovary, nous rappelle que rêver sans limites peut nous éloigner du réel, nous empêchant de goûter pleinement ce qui est. À force de poursuivre des chimères, on risque d’oublier que le réel, bien qu’imparfait, recèle ses propres richesses. Rêver est une force essentielle, mais il doit s’accompagner de la capacité à apprécier le présent, dans toute son imperfection et ses surprises. En fin de compte, le défi est peut-être d’enchanter le réel plutôt que de s’y soustraire.
Enchanter le réel : une alternative aux illusions du rêve

Et si la véritable clé résidait, comme le suggère Marianne Chaillan, dans l’art d’enchanter le réel ? Rêver est une force puissante, mais pour qu’il ne devienne pas un piège, il doit se conjuguer avec une capacité à accueillir pleinement le présent, dans toute sa complexité. Enchanter le réel, c’est apprendre à transformer notre regard sur le quotidien : trouver de la magie dans l’ordinaire, savourer les petites victoires, et voir la beauté dans l’imparfait et l’accepter comme faisant partie intégrante de l’expérience humaine. C’est comprendre que l’épanouissement ne réside pas seulement dans la réalisation d’idéaux lointains, mais aussi dans la richesse des moments simples et inattendus. Habiter sa vie ainsi, c’est choisir de construire une existence où rêves et réalité cohabitent en harmonie pour éviter de nous éloigner du bonheur véritable.